
Une personne est en arrêt cardiaque lorsque son cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d’une façon anarchique
Une victime est considérée comme étant en arrêt cardiaque lorsqu’elle a perdu connaissance et :
• ne respire pas : aucun mouvement de la poitrine n’est visible et aucun bruit ou souffle n’est perçu
• ou présente une respiration anormale avec des mouvements respiratoires inefficaces, lents, bruyants et anarchiques (gasps).

Quelles sont les causes ?
L’arrêt cardiaque peut être causé par certaines maladies du cœur comme l’infarctus du myocarde.
Chez l’adulte, dans près de 50 % des cas, cet arrêt cardiaque soudain est lié à une anomalie de fonctionnement électrique du cœur : la fibrillation ventriculaire.
Il peut aussi être consécutif à une détresse circulatoire (hémorragie).
L’arrêt cardiaque peut aussi être consécutif à une obstruction totale des voies aériennes, une intoxication, un traumatisme ou une noyade…
Dans ce cas l’arrêt cardiaque est en général secondaire à un manque de dioxygène.
Quels sont les risques ?
Le risque d’un arrêt cardiaque est la mort de la victime à très brève échéance.
Au cours d’un arrêt cardiaque, les lésions du cerveau, consécutives au manque d’apport de dioxygène, surviennent dès la première minute.

Le sauveteur doit permettre la réalisation d’une série d’actions pour augmenter les chances de survie de la victime :
• alerter de façon précoce les secours
• réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) précoce
• assurer la mise en oeuvre d’une défibrillation précoce.



Ces différentes étapes constituent une chaîne de survie susceptible d’augmenter de 4 à 40 % le taux de survie des victimes.
Chaque minute gagnée dans la mise en place d’un défibrillateur automatisé externe (DAE) peut augmenter de 10 % les chances de survie de la victime.
Conduite à tenir
• Apprécier l’état de conscience de la victime (voir la victime est inconsciente et respire);
En l’absence de réponse ou de réaction de la part de la victime :
• appeler « à l’aide », si le sauveteur est seul ;
• l’allonger sur le dos ;
• libérer les voies aériennes ;
• apprécier la respiration sur 10 secondes au plus.
(voir la victime est inconsciente et respire);
En l’absence de respiration, en présence de gasps ou en cas de doute,
Si un tiers est présent:
• faire alerter les secours et réclamer un DAE
• pratiquer une RCP en répétant des cycles de 30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations
• faire mettre en oeuvre ou mettre en oeuvre le DAE le plus tôt possible et suivre ses indications
• poursuivre la réanimation entreprise jusqu’au relais par les services de secours ou à la reprise d’une respiration normale.
Si aucun tiers n’est présent :
• alerter les secours
• en l’absence de DAE, pratiquer une RCP en répétant des cycles de 30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations
• si un DAE est à proximité, le mettre en oeuvre le plus tôt possible et suivre ses indications
• poursuivre la réanimation entreprise jusqu’au relais
par les services de secours ou à la reprise d’une respiration normale.
En cas de reprise d’une respiration normale :
• cesser les manoeuvres de réanimation
• adopter la conduite à tenir adaptée à une victime présentant une perte de connaissance.
Techniques de la RCP
Quel que soit l’âge de la victime, il convient de :
• l’installer en position horizontale, sur le dos, préférentiellement sur une surface rigide
• se placer auprès d’elle, le plus souvent à genoux
• dénuder la poitrine de la victime, dans la mesure du possible
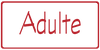
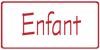

Compressions thoraciques
• placer le talon d’une main au centre de la poitrine, sur la ligne médiane, sur la moitié inférieure du sternum
• placer l’autre main au-dessus de la première en entrecroisant les doigts des deux mains.
La seconde main peut aussi être placée à plat sur la première, en veillant à relever les doigts pour qu’ils ne restent pas en contact avec le thorax
• réaliser des compressions sternales de 5 à 6 cm tout en veillant à :
• conserver les bras parfaitement verticaux ;
• tendre les bras
• verrouiller les coudes
• maintenir une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute.
• assurer un temps de compression égal à celui du relâchement
• entre chaque compression, laisser le thorax reprendre sa forme initiale, sans décoller les mains.
• Placer le talon d’une main un doigt au-dessus d’un repère constitué par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes
• relever les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes
• réaliser les compressions sternales comme chez l’adulte en veillant à enfoncer le thorax sur le tiers de son épaisseur.
• Placer la pulpe de deux doigts d’une main dans l’axe du sternum, un doigt au dessus d’un repère constitué par le bas du sternum à la jonction des dernières côtes
• réaliser les compressions sternales dans les mêmes conditions que chez l’enfant.


Insufflations
• basculer la tête de la victime en arrière comme pour la technique de libération des voies aériennes
• pincer le nez de la victime entre le pouce et l’index, tout en maintenant la bascule en arrière de la tête avec la main qui est placée sur le front
• ouvrir légèrement la bouche de la victime en utilisant l’autre main et maintenir le menton élevé
• inspirer, sans excès
• appliquer la bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fermement
• insuffler progressivement jusqu’à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever (durant 1 seconde environ)
• se redresser légèrement afin de :
• reprendre son souffle
• vérifier l’affaissement de la poitrine de la victime
• insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions.
La durée de réalisation de ces deux insufflations successives ne doit pas excéder 5 secondes.
Si le ventre ou la poitrine de la victime ne se soulève pas lors des insufflations :
• s’assurer que la tête de la victime est en bonne position et que son menton est élevé
• s’assurer qu’il y a une bonne étanchéité et pas de fuite d’air lors de l’insufflation
• rechercher la présence d’un corps étranger dans la bouche. Le retirer avec les doigts, si nécessaire.
La technique est sensiblement la même que pour l’adulte ou l’enfant.
Toutefois, il convient de :
• placer la tête du nourrisson en position neutre, menton élevé
• englober avec la bouche à la fois la bouche et le nez de la victime
• insuffler des volumes d’air sensiblement moindres que pour l’enfant.

Le défibrillateur
Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil qui permet :
• d’analyser l’activité électrique du coeur de la victime
• de reconnaître une anomalie du fonctionnement électrique du coeur à l’origine de
l’arrêt cardiaque
• de délivrer ou d’inviter le sauveteur à délivrer un choc électrique, afin d’arrêter l’activité électrique anarchique du cœur.
Le défibrillateur automatisé externe est composé :
• d’un haut-parleur qui guide le sauveteur dans son action
• d’un accumulateur d’énergie qui permet de réaliser des chocs électriques
• éventuellement, d’un bouton qui permet de délivrer le choc électrique
Le DAE est toujours accompagné d’une paire d’électrodes de défibrillation pré-gélifiées autocollantes avec câble intégré. Ces électrodes, à usage unique, sont contenues dans un emballage hermétique.
Une seconde paire doit être disponible en cas de défaillance de la première.
Plusieurs accessoires peuvent être joints au défibrillateur dont :
• une paire de ciseaux, pour couper les vêtements et dénuder la poitrine de la victime
• des compresses ou du papier absorbant, pour sécher la peau de la poitrine de la victime si elle est mouillée ou humide
• d’un rasoir jetable pour raser les poils de la victime, s’ils sont particulièrement abondants, à l’endroit où l’on colle les électrodes.
Localisation
Actuellement, les DAE mis à disposition du public sont de plus en plus nombreux, on les trouve notamment dans :
• les halls d’aéroports et les avions des grandes compagnies aériennes ;
• les grands magasins, les centres commerciaux ;
• les halls de gares, les trains ;
• les lieux de travail ;
• certains immeubles d’habitation…
Dans ces cas, les appareils sont parfois placés dans des armoires murales repérées par un logo facilement identifiable.

Utilisation du défibrillateur
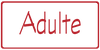
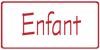

• Mettre en fonction le défibrillateur
• suivre les indications de l’appareil, impérativement
Ces indications précisent, dans un premier temps, de mettre en place les électrodes.
Pour cela :
• enlever ou couper les vêtements recouvrant la poitrine de la victime, si nécessaire
• sécher le thorax de la victime s’il est humide ou mouillé
• choisir les électrodes «Adultes» de l’appareil
• déballer et appliquer les électrodes, l’une après l’autre, sur le thorax de la victime,
dans la position indiquée sur le schéma figurant sur l’emballage
• connecter les électrodes au défibrillateur, si nécessaire.
Une fois collées sur la peau du thorax de la victime, les électrodes permettent :
• de capter et transmettre l’activité électrique cardiaque au défibrillateur ;
• de délivrer le choc électrique lorsqu’il est indiqué.
Lorsque le DAE l’indique, ne plus toucher la victime et s’assurer que les personnes aux
alentours fassent de même.
Si le défibrillateur annonce que le choc est nécessaire :
• demander aux personnes aux alentours de s’écarter ;
• laisser le DAE déclencher le choc électrique ou appuyer sur le bouton «choc»
lorsque l’appareil le demande ;
• reprendre immédiatement les compressions thoraciques après la délivrance du
choc.
Si le défibrillateur annonce que le choc n’est pas nécessaire :
• reprendre immédiatement les compressions thoraciques.
La défibrillation doit être réalisée avec des appareils adaptés (électrodes enfants, réducteur d’énergie…).
En l’absence d’un DAE adapté, un DAE «Adulte» peut être utilisé.
Les électrodes adultes sont alors positionnées en avant au milieu du thorax pour l’une et au milieu du dos pour
l’autre.
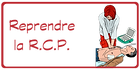
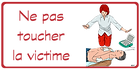

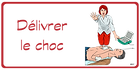
Risques et contraintes
Si la victime présente un timbre autocollant médicamenteux sur la zone de pose des électrodes,
le sauveteur retire le timbre et essuie la zone avant de coller l’électrode.
Si la victime présente un stimulateur cardiaque (le plus souvent le sauveteur constate une cicatrice et perçoit un boîtier sous la peau, sous la clavicule droite ou est informé par la famille) à l’endroit de pose de l’électrode,
le sauveteur colle l’électrode à un travers demain de l’appareil (environ 8 cm de la bosse perçue).
Si la victime est allongée sur un sol mouillé (bord de piscine, pluie…), ou si son thorax est mouillé,
le sauveteur, si possible, déplace la victime pour l’allonger sur une surface sèche, et, si possible, sèche son thorax, avant de débuter la défibrillation.
Si la victime est allongée sur une surface en métal :
si c’est possible, et en se faisant aider si besoin, le sauveteur déplace la victime ou glisse un tissu sous elle (couverture…) avant de débuter la défibrillation.
Si le DAE détecte un mouvement au cours de l’analyse,
le sauveteur doit s’assurer de ne pas toucher la victime au cours de l’analyse. En l’absence de contact avec la victime, il vérifie la respiration de celle-ci.
Si le DAE demande toujours de connecter les électrodes alors que cette opération a déjà été effectuée,
le sauveteur, vérifie que :
• les électrodes sont bien collées et le câble de connexion correctement connecté au DAE
• si le problème n’est pas résolu, et qu’une seconde paire d’électrodes est disponible, remplacer les électrodes.
